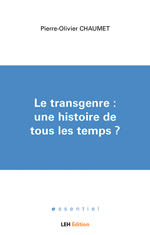| FICHE TECHNIQUE | |
|---|---|
| Parution | 01/07/2015 |
| Rayon | Histoire |
| Collection | Essentiel |
| ISBN | 978-2-84874-612-8 |
| Format | 115x180 mm |
| Nbre de page | 164 pages |
Au XXIe siècle, la notion de « transgenre » englobe au sens large du terme un groupe d’individus dans lequel peuvent à la fois se retrouver des travestis, des transsexuels ou des individus psychologiquement androgynes. Le mot semble donc concerner plusieurs types d’expression identitaire. D’une manière générale, ces individus considèrent que leur identité sexuelle, attribuée à la naissance, ne correspond en rien à leur « être intérieur ». Selon cette définition, une personne dite « transgenre » (opérée ou non) s’avère dans son quotidien en opposition totale avec les normes attendues de son sexe biologique. Dans son comportement, ses moeurs ou ses tenues vestimentaires, elle ne répond en rien aux attentes ou repères déterminés par la société. Or, de Pline l’Ancien à l’abbé de Choisy, du chevalier d’Éon au psychiatre français Jean Esquirol, témoignages et preuves affluent dans l’Histoire concernant cette question de l’ambiguïté de genre. Depuis près de deux millénaires, force est de constater que des hommes ou des femmes se sont retrouvés dans cette situation particulièrement perturbante : celle de ne pas réussir à se conformer réellement à leur identité sexuelle.